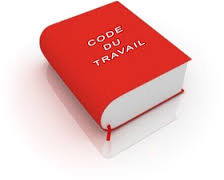La biscuiterie Jeannette, fondée en 1850, a été placée en liquidation judiciaire le 3 janvier 2014. Les 37 ex-salariés ne se résolvent pas à la disparition de l’entreprise, et occupent depuis février leur ancienne usine pour éviter la saisie des machines et leur vente aux enchères. Périodiquement ils produisent des madeleines qui rencontrent un vif succès.
Un entrepreneur souhaitant relancer l’activité de cette marque symbole de la Normandie a lancé une collecte en ligne sur le site de financement participatif Bulb in town. Et ça a marché : 2 076 internautes ont promis de lui verser, bien au-delà de l’objectif de 50 000 euros qu’il s’était fixé, 100 882 euros qui attestent de l’engouement des consommateurs.
Si le tribunal de commerce de Caen choisit son projet de reprise, les contributeurs obtiendront des contreparties : selon le niveau de leur financement, d’une inscription à vie au Club Jeannette à un abonnement mensuel à la totalité de la gamme des madeleines
Ce projet de reprise est le seul parmi les sept offres déposées à prévoir la reprise de salariés, une dizaine et il relance l’espoir. Seul hic : Continuer la lecture